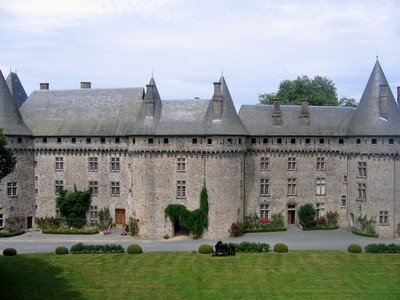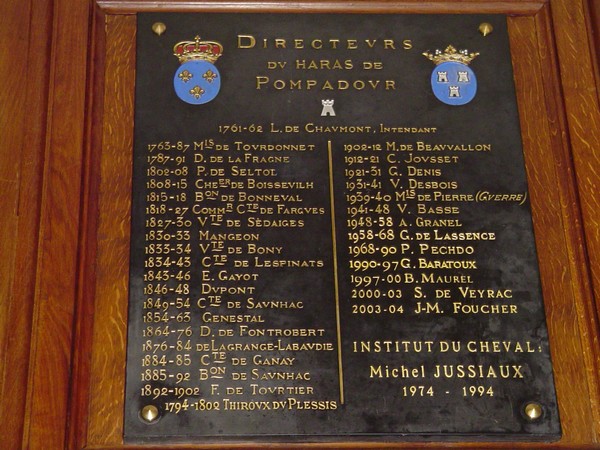L'Histoire du haras de Pompadour
|
|
|
|
|
Puy Marmont, dépot d'étalons. Le pavillon d'honneur vu de la grande allée |
Le
nom de "Pompadour" est éteint depuis 1736. Madame
Lenormand d'Etioles obtient du roi le titre et les terres du Marquisat
de Pompadour en 1745. Pour ne pas être en reste avec les propriétaires terriens
du Limousin présents à
C'est par un arrêté du 28 janvier
1764 que Louis XV, à nouveau propriétaire des terres
du Marquisat, fonde le Haras royal de Pompadour, avec son grand écuyer le prince de Lambesc.
Le Haras royal de Pompadour sera
dirigé par M. de Tourdonnet jusqu'en 1787.
L'intendance
de ce nouvel établissement sera confié à Bertrand
Lamoureux de Chaumont fils. Son père était le régisseur de
Pour irriguer les prés de
De 1764 à 1782, de nouveaux étalons
sont envoyés à Pompadour. Les premiers croisements avec la jumenterie limousine
sont tentés sans grands succès, faute de méthodes rationnelles. En 1779, une
mission ramène d'Orient 8 chevaux syriens. Arnaud
Beaune de
En 1791, son fils sera le 3ème directeur du haras royal de Pompadour. On lui
doit les écuries sous le château à la place de l'Orangerie, la rampe d'accès
aux terrasses du château et l'écurie dite "de l'Horloge" à
En 1791, les "Fragne" choisissent l'émigration.
A
|
Le château de Pompadour, vue générale face sud |
L'écurie dite "de l'entraînement" à l'emplacement de l'ancienne orangerie |
|
En 1804, le
chevalier Lepiot de Seltot, prend la direction de l'établissement. Napoléon 1er amène ses meilleurs chevaux à Pompadour
(souvent ses montures personnelles.) La campagne d'Egypte fournira un nouvel
apport de sang arabe. M. Lepiot de Seltot doit
accueillir au haras des troupeaux hétéroclites de moutons mérinos et de buffles
laineux qui refusent de féconder les vaches limousines, ce pour quoi ils
avaient été acquis. Ce n'est pas le cas des bovins roumains ornés de cornes prodigieuses
mais dont la robe gris clair indisposait les éleveurs locaux plus accoutumés à
la robe rouge de leurs vaches limousines. Enfin en 1809, il fit décider de
renvoyer dans leur pays d'origine tous ces hôtes pour le moins curieux. M. Lepiot de
Seltot fait intercepter à Limoges un étalon arabe : Bagdad, présent des Anglais à l'ambassadeur de
Russie. En Les missions d'achats en Egypte et
en Syrie se succèdent. Au cours de l'une d'elles, le
Vicomte Desportes achète l'étalon Massoud.
La transaction sera difficile et durera 4 jours. Lorsqu'elle est sur le point
d'aboutir, le vendeur enfourche son cheval et disparaît dans le désert. Enfin,
au 4ème jour, la transaction s'opère mais le vicomte doit rajouter en plus la
valeur d'un pantalon turc. Massoud
fera souche à Tarbes, au Pin et à Pompadour. Tout au long de ses missions, le vicomte Desportes se plaint des innombrables pots
de vin qu'il doit verser à ses interlocuteurs. C'est le
baron de Bonneval qui prend la direction du haras en 1816. En poste à Pau,
il réalise les premiers croisements, préludes de la race anglo-arabe. Il
pratique l'alternance avec l'apport successif de sang arabe et de sang anglais.
Pour lui, dans l'élevage, le père donne le sang et l'énergie, la mère, la
puissance et le gros. Ce principe s'applique surtout en Limousin où le climat
et la nature du sol portent à l'énergie et non à la puissance. Le passage à
Pompadour de M. de Bonneval lui permet de
débuter la réorganisation de |
|
La
sellerie d'honneur. Au premier plan, selle d'apparat
offerte par le roi du Maroc. |
|
En
1818, le Comte des Fargues est à la tête de
l'établissement. Il entreprend d'importants travaux. Avec lui, les terrasses du
château trouvent leur aspect actuel, débarrassées des masures qui les
encombrent. Avec l'aide du baron Finot, préfet
de Le 30 janvier 1834, un violent
incendie ravage le château. Le directeur M. de Bony,
convaincu d'absence illégale, est révoqué mais il sera nommé quelques mois plus
tard inspecteur honoraire. Le régisseur, M. Antonin de Lespinats, devient directeur. Avec M. de Lespinats, l'anglo-arabe écrira ses premières
lettres de noblesse. L'apport de sang arabe est privilégié avec des missions
d'achat en Syrie. Pour le sport, la prairie face au château est aménagée en
hippodrome. Les premières courses se déroulent en 1837. Massoud
disparaît en1843 à l'issue d'un ultime saut. L'administration de M. de Lespinats fait des envieux. Son comportement de
maquignon l'amène à commettre un délit d'initié. Il sera muté au Pin. Il
rejoint sa nouvelle affectation à bride abattue, aux guides d'un puissant
attelage de chevaux limousins en 47 heures à près de 10km par heure de moyenne. Eugène Gayot
fera le chemin inverse. Sous son administration du haras de Pompadour, la race
anglo-arabe sera définitivement reconnue, race dont on dit qu'il suffit à l'homme
de la comprendre pour être moins idiot . L'apport de sang arabe dans la
jumenterie est renforcé. M. Gayot dira de Massoud : "Il a la valeur du diamant." |
|||
|
|||
 es
premières
traces écrites d'un élevage raisonné à Pompadour remontent au 8 mars 1689 :
es
premières
traces écrites d'un élevage raisonné à Pompadour remontent au 8 mars 1689 :